La Résistance dans le Morvan





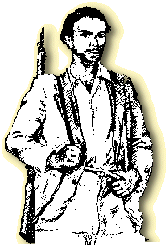 Le
1er septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne
par l'armée allemande, débute
la Seconde Guerre Mondiale. En mai 1940 les Pays
Bas, la Belgique et le Luxembourg sont envahis,
le 14 juin les Allemands sont à Paris, ils arrivent aussi dans le Morvan.
L'armistice est signé le 22, la France est coupée en deux. La
"ligne de démarcation", frontière intérieure
étanche qui sépare le nord et l'ouest du pays occupé
du sud dit libre ("zone non occupée", surnommée "zone
nono"), passe au sud du Morvan.
Le
1er septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne
par l'armée allemande, débute
la Seconde Guerre Mondiale. En mai 1940 les Pays
Bas, la Belgique et le Luxembourg sont envahis,
le 14 juin les Allemands sont à Paris, ils arrivent aussi dans le Morvan.
L'armistice est signé le 22, la France est coupée en deux. La
"ligne de démarcation", frontière intérieure
étanche qui sépare le nord et l'ouest du pays occupé
du sud dit libre ("zone non occupée", surnommée "zone
nono"), passe au sud du Morvan.
Région de collines boisées isolée des grands axes de
communication (ni grande route, ni voie ferrée importante), fermes
isolées, cachettes nombreuses, le Morvan offre tout ce qu'il faut à
ceux qui cherchent à fuir l'occupation allemande (communistes, juifs,
et surtout réfractaires au S.T.O. (Service du Travail Obligatoire
en Allemagne). La situation géographique (à quelques kilomètres
de la ligne de démarcation) et administrative (le Morvan est à
cheval sur quatre départements) favorise encore plus les activités
de résistance encouragées, sans aucun doute, par une population
rude, courageuse, et à l'esprit souvent frondeur. L'armée allemande,
bien consciente de cette situation, n'installe d'ailleurs pas de poste militaire
permanent (Kommandantur) dans le Morvan même, à l'exception de
Château-Chinon occupée par des Ukrainiens sous uniforme allemand.

Ce contexte, aggravé par des réquisitions
de plus en plus nombreuses, forme un creuset dans lequel
les mouvements de Résistance se développent
rapidement et facilement et déstabilisent
l'ennemi : ce sont les F.F.I. (Forces Françaises
de l'Intérieur) à ne pas confondre avec les F.F.L. (Forces
Françaises Libres). Regroupés en Maquis, c'est à
dire en petits groupes autonomes, ils ont à leur tête un chef
dont on ne connaît à l'extérieur que le surnom :
Sanglier (Henri Dennes) à Lormes,
Camille
(Paul Bernard) ou Julien (Pierre Henneguier) dans les environs
de Lormes,
Bernard
(Louis Aubin) à Ouroux, Mariaux (Fernand Vessereau) à
Crux-la-Ville, Socrate (Georges Leyton) près d'Autun. En liaison
radio avec la France Libre à Londres, ils participent à
des attaques visant la destruction des voies de communications, des lignes
téléphoniques et électriques, des outils de production.
Au milieu des résistants des chefs se lèvent comme Jean
Longhi (dit Grandjean) qui coordonne l'ensemble des Maquis de la
Nièvre. Ils stimulent les énergies et dirigent les actions au
risque de leur vie. Dès le 22 novembre 1942, les maquis du Morvan reçoivent
leur premier parachutage d'armes et de matériel dans la Forêt
au Duc entre Quarré-les-Tombes et Dun-les-Places
au nord de Lormes. Le colonel Roche (dit Moreau) est chargé
d'organiser les divers groupes armés et s'installe entre Ouroux et
Montsauche.
Les représailles sont nombreuses. Les Allemands pensent ainsi pouvoir
provoquer une rupture définitive entre les Maquisards et la population,
c'est le contraire qui se produit. Dans ce but, le village de Dun-les-Places,
à quelques kilomètres de Lormes, est choisi par l'Etat-Major
allemand comme village-type destiné à la formation et l'entraînement
des élèves-officiers à la lutte contre les maquis. Les
Nazis veulent leur inculquer le concept de la terreur exercée sur la
population civile qui aide la Résistance.
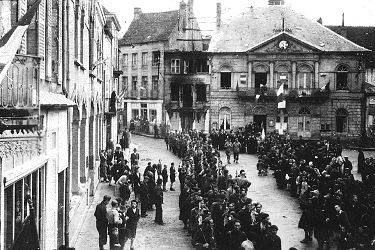
Lors du débarquement allié en Normandie
(6 juin 1944) le Morvan compte une trentaine de maquis
dont les effectifs totaux approchent les dix mille
hommes au moment de la Libération. En août
1944, l'armée allemande prend conscience de la nécessité
de replier ses troupes du sud-ouest de la France en passant par le Morvan,
en raison de la pression de l'armée de Patton (au nord) et d'un débarquement
probable des alliés en Méditerranée. C'est pourquoi les
troupes d'occupation tentent de faire sauter le verrou que constituent trois
importants maquis de la région de Saint Saulge (Julien, Daniel
et Mariaux). C'est la bataille de Crux-la-Ville (du 12 au 16 août)
où 1500 Allemands appuyés par de l'artillerie et de l'aviation
ne réussissent pas à réduire 800 maquisards encerclés.
Ces derniers, aidés par les F.F.I. du Morvan et les F.T.P. (Francs
Tireurs et Partisans) du Val de Loire, décrochent après
avoir fait subir des pertes sévères à l'assaillant.
Huit hommes fusillés à Lormes le 12 juin 1944, vingt-sept quelques
jours plus tard à Dun-les-Places, les villages de Montsauche et Planchez
incendiés : le Morvan a payé un lourd tribut à sa
libération. Mais sa fierté est, sans doute, de s'être
libéré seul dans le courant du mois d'août, le général
américain Patton ayant même demandé aux Maquis du Morvan
d'assurer la protection du flanc sud de ses armées.

A la Libération des monuments sont érigés, des plaques commémoratives et des lieux de mémoire, comme le très émouvant cimetière franco-britannique du Maquis Bernard ou le cimetière de Dun les Places, rappellent à jamais cette terrible et glorieuse époque. Un des plus beaux hommages qui puisse être rendu à la Résistance est, pour moi, la modeste plaque apposée sur la mairie de Lormes : "Et s'il était à refaire, je referais ce chemin (Aragon)".